Les Pensées de Pascal
"Ferox gens nullam esse vitam sine armis rati,
Ils aiment mieux la mort que la paix, les autres aiment mieux la mort que la guerre. Toute opinion peut être préférable à la vie, dont l'amour paraît si fort et si naturel. »
Vanité, (Fragment 63, Sellier)
Enquête dans le milieu des théologiens : en écrivant la première Provinciale, Pascal ne pensait pas entamer une série de « petites lettres ». Elle prend la défense d’Antoine Arnauld dans le procès qui lui est fait en Sorbonne sur sa Seconde lettre à un duc et pair. Pascal y montre que le terme de pouvoir prochain, que ses ennemis lui reprochent, ne sert qu’à couvrir un complot malveillant destiné à l’exclure de la Faculté de théologie. Une mise en scène comique donne à cette défense un caractère propre à porter devant le public laïc (que représente le provincial destinataire fictif des lettres ouvertes) un débat que les théologiens comptaient régler en interne.
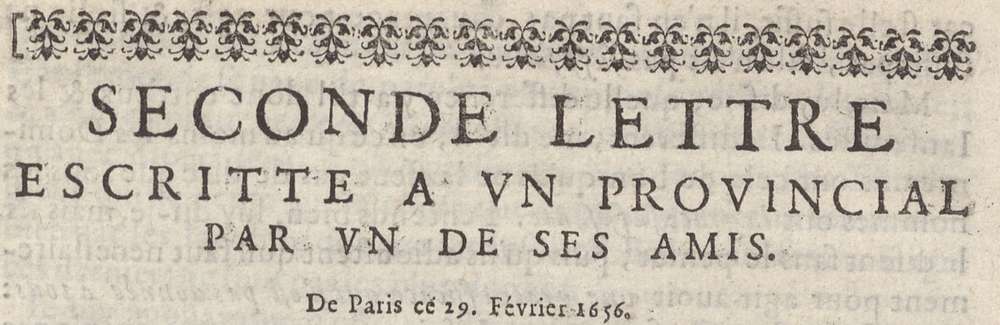
La parabole des médecins : avec la même mise en scène que dans la première, la deuxième Provinciale traite un problème proche du précédent, à propos de la grâce suffisante, dont Pascal dévoile les équivoques.
Le fantôme du janséniste : dans la troisième Provinciale, Pascal démontre l’injustice, l’absurdité et la nullité de la censure que ses ennemis ont obtenue contre Antoine Arnauld.
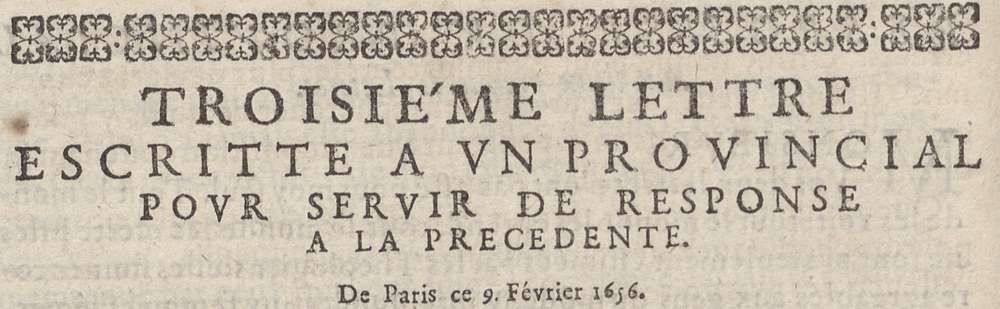
Difficile de commettre un pêché : la quatrième Provinciale revient sur les questions de théologie, à propos de la grâce actuelle et du péché d’ignorance : il s’en prend aux théologiens molinistes et les jésuites, qui interprètent ces notions dans un sens jugé absurde. Le ton a changé, et certains passages prennent un tour moins comique que dans les précédentes lettres.
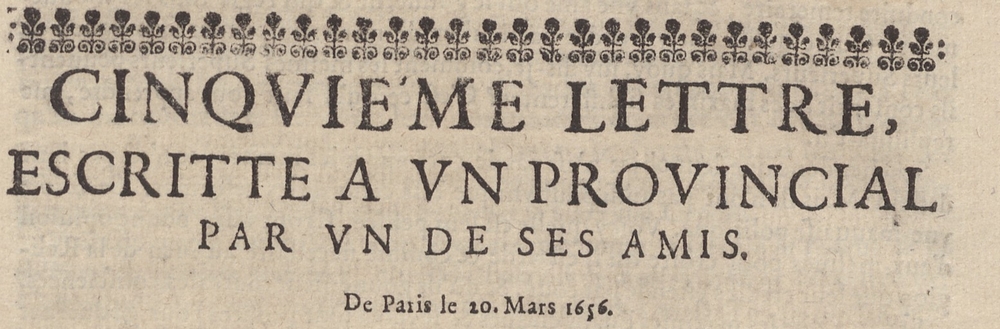
Qui sont les casuistes ? : avec la cinquième Provinciale, Pascal change d’objet : il s’en prend à la morale des casuistes probabilistes, qui à ses yeux corrompent la morale chrétienne par leurs interprétations. Cette stratégie s’étend jusqu’à la dixième Provinciale.
Instruction aux domestiques : la sixième Provinciale fournit une suite de maximes de morale passablement laxistes appliquées par les casuistes aux prêtres, aux bénéficiers, aux religieux et aux domestiques.
Comment tuer à bon escient ? : dans la même orientation que la précédente, la septième Provinciale s’en prend aux maximes des casuistes en faveur de la défense de l’honneur et des biens.
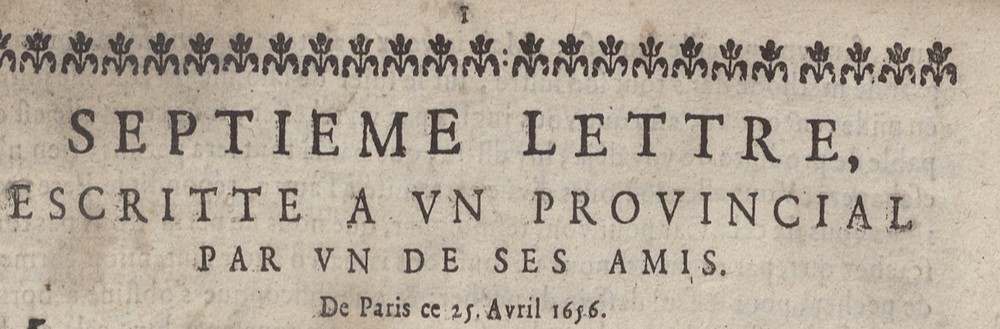
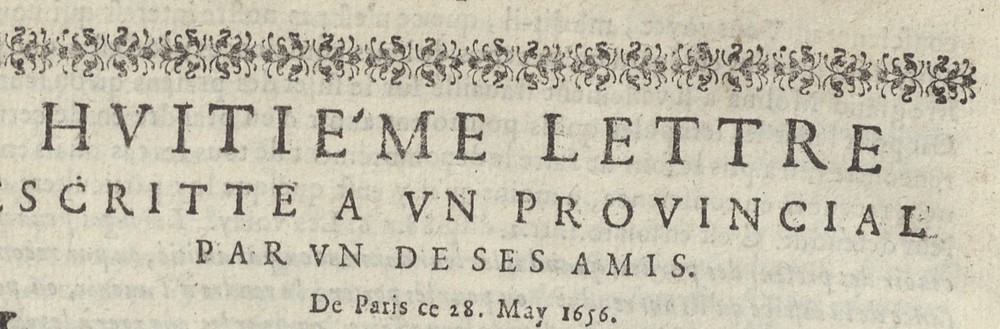
Peut-on vendre une décision judiciaire ? : la huitième Provinciale traite des maximes des casuistes pour les juges, les usuriers, les banqueroutiers.
Un exemple de dévotion facile : la neuvième Provinciale propose une liste de maximes des casuistes applicables à l’ambition, l’envie, la gourmandise, les équivoques, les restrictions mentales, les filles et les femmes, le jeu et la présence à la messe.
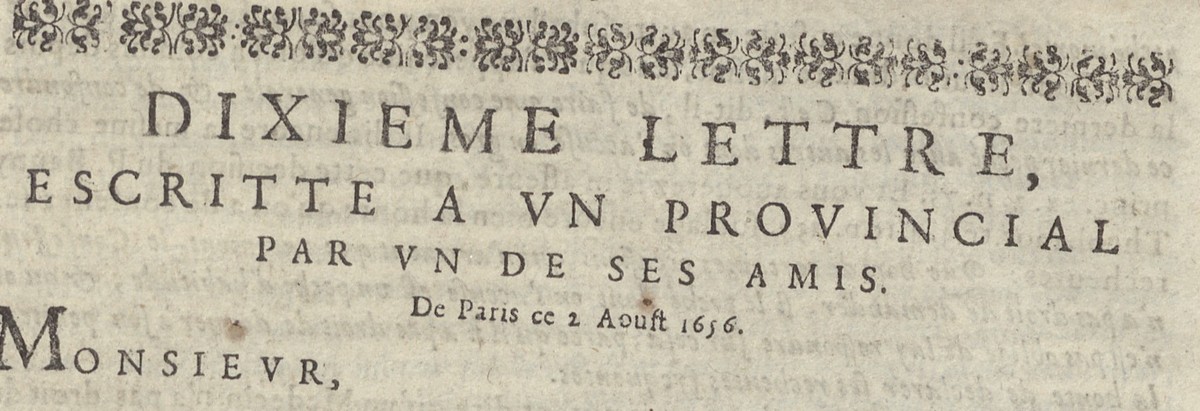
Quand faut-il aimer Dieu ? : avec la dixième Provinciale, Pascal clôt sa présentation ironique des maximes des casuistes par celles qui touchent la confession, l’absolution, la contrition et l’amour de Dieu.
Règles pour une polémique chrétienne : avec la onzième Provinciale, Pascal amorce un nouveau changement d’orientation : il s’adresse désormais directement aux jésuites, pour défendre le ton et la méthode des lettres précédentes. Son style change aussi : l’ironie laisse place à une éloquence plus soutenue, pour traiter un problème sérieux : quelles sont les règles qu’un auteur doit respecter dans les polémiques qui exigent que l’on défende la religion chrétienne ?
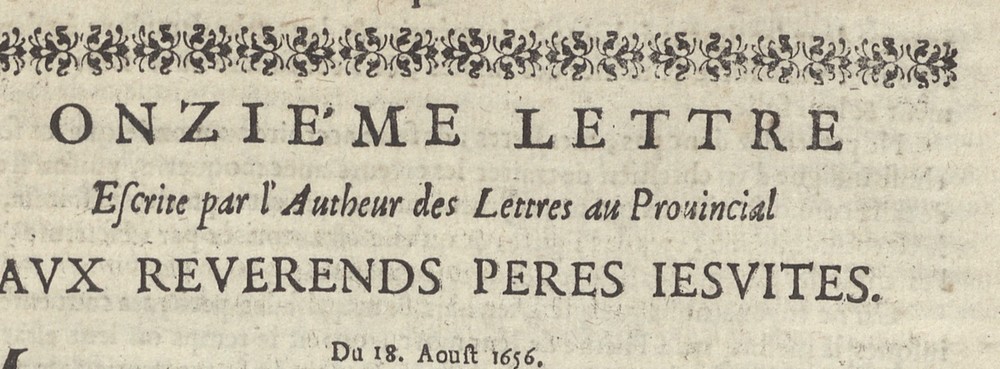
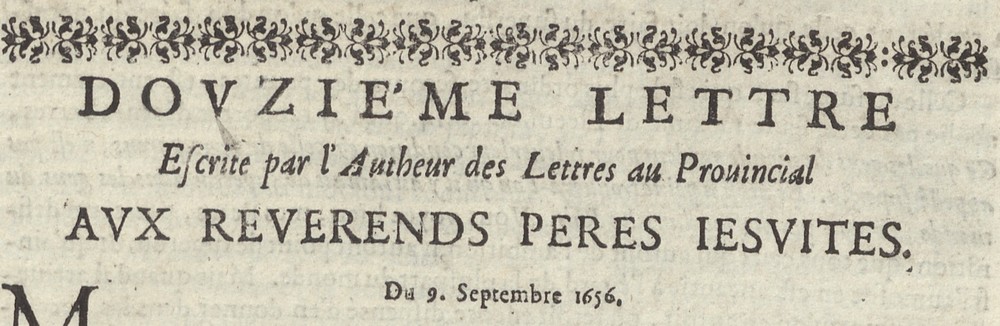
La violence et la vérité : la douzième lettre entame une série dans laquelle Pascal répond aux polémistes jésuites qui ont entrepris de répondre aux Provinciales, pour en démonter les mauvais raisonnements. Cette lettre s’achève sur un puissant tableau du combat de la violence contre la vérité.
La treizième Provinciale répond au jésuite Jacques Nouët, sur la distinction que les casuistes soutiennent entre la théorie et la pratique en morale.
La quatorzième Provinciale revient sur des sujets aussi sensibles en morale que la permission de l’homicide.
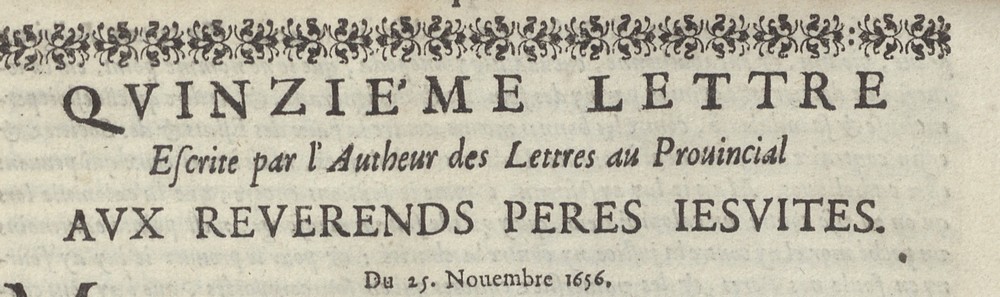
Définition de la calomnie : dans la quinzième Provinciale, Pascal s’oppose aux calomnies que les polémistes jésuites répandent contre lui, et présente une théorie générale de la diffamation et de la manière de s’y opposer.La seizième Provinciale prolonge la précédente sur la calomnie, en défendant particulièrement les religieuses de Port-Royal.
Un justicier masqué ? : la dix-septième Provinciale revient sur les problèmes de théologie, pour montrer que l’hérésie janséniste est une invention des jésuites, et que, sur les questions de fait, l'autorité du pape n’est pas infaillible.
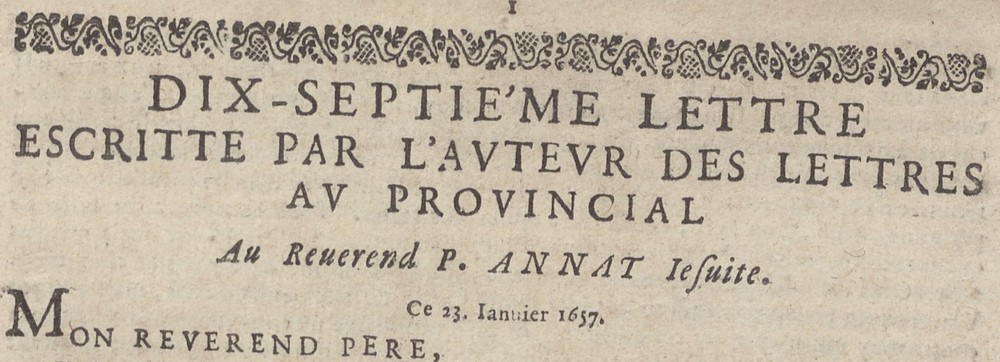
La dix-huitième Provinciale poursuit la défense de la précédente, pour établir que les jansénistes ne forment en aucune façon une hérésie au sein de l’Église.
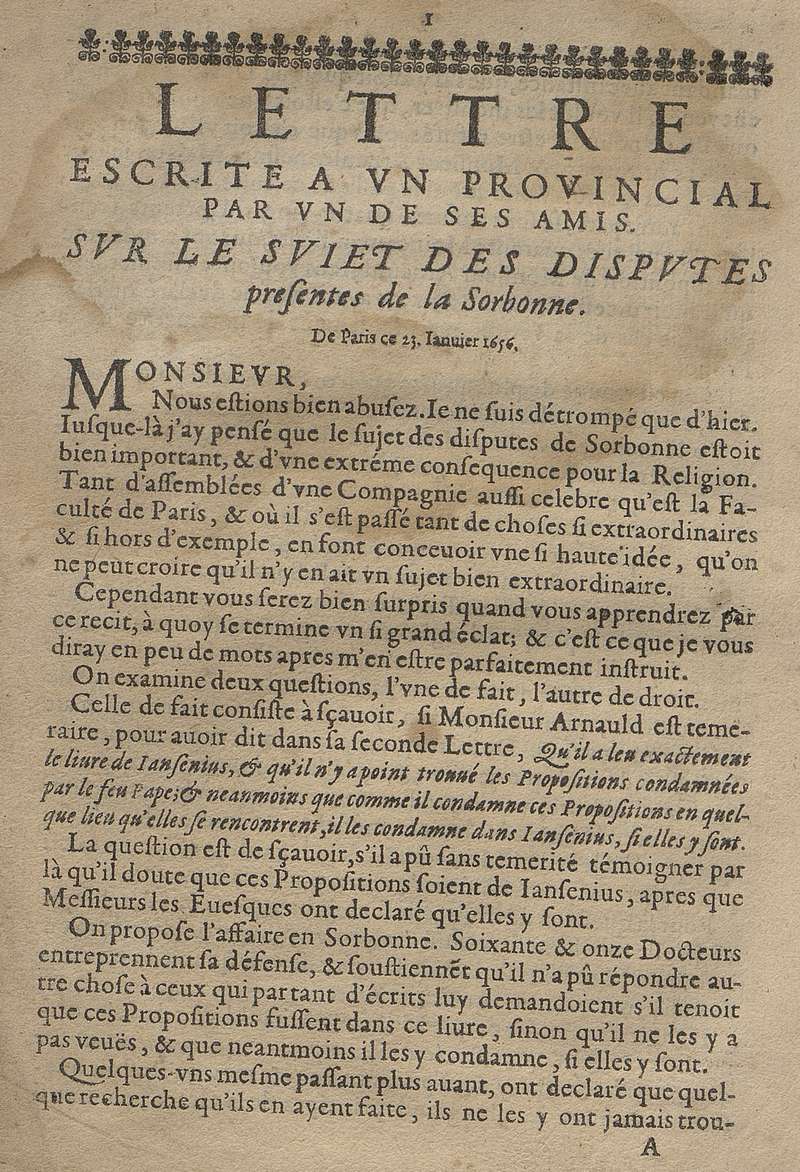
Les Provinciales sont des lettres ouvertes, par le moyen desquelles du 23 janvier 1656 au 24 mars 1657, Pascal prend la défense de son ami le docteur de Sorbonne Antoine Arnauld, l’un des principaux maître du mouvement augustinien en France, contre la censure dont le menaçe la faculté de théologie de Paris. Elles tirent leur titre de la fiction par laquelle elles sont écrites par un honnête homme parisien à un ami que sa condition de provincial empêche de recevoir facilement des nouvelles de la capitale. Ces brochures anonymes de huit à douze pages, écrites en un français élégant et accessible (et non dans le latin des théologiens et des savants), connaissent immédiatement l’un des plus grands succès littéraire du siècle. Pascal est bientôt contraint de se cacher pour échapper aux recherches de la police et des jésuites.
Les quatre premières Provinciales tournent autour des problèmes théologiques de la grâce et de la liberté humaine. La condamnation d’Arnauld acquise, à partir de la cinquième lettre jusqu’à la dixième, Pascal se tourne contre les opinions de morale jugée relâchée répandues par les casuistes et les jésuites, qui conduisent à autoriser toutes sortes de délits, voire de crimes : mensonge, vol, meurtre... Après avoir usé de l’ironie et du comique qui feront son succès, Pascal est contraint de changer de ton à partir de la onzième lettre pour faire face aux réponses très violentes des jésuites. La onzième lettre est consacrée à la défense de sa rhétorique. Bientôt, Pascal passe à la contre-offensive, réfutant les arguments et les citations falsifiées de ses adversaire (Provinciales 12 à 14), et les convainquant de calomnie (Provinciales 15 et 16). Les deux dernières lettres sont consacrées à un retour aux problèmes de théologie de la grâce.
La campagne des Provinciales vise principalement à alerter sur les errements des jésuites le public du monde et surtout les curés des paroisses. A l’appel des curés parisiens, un réseau se constitue dans les villes de Rouen, de Nevers, d’Evreux, qui entreprend d’en appeler aux autorités religieuses, parlementaires et politiques du royaume. Pascal interrompt alors la série des Provinciales pour mettre sa plume au service de cette campagne collective, en composant quatre Écrits pour les curés de Paris.
L’idéal de clarté, de précision et d’élégance dont Pascal a donné l’exemple a marqué jusqu’à ses adversaires posthumes, comme Voltaire et de nombreux polémistes des temps modernes. Certaines lettres contiennent certains de ses morceaux les plus beaux, notamment la conclusion de la XIIe, sur l’éternel combat de la violence et de la vérité, la XIe sur les règles d’une polémique non-violente, et la XVe sur la calomnie.
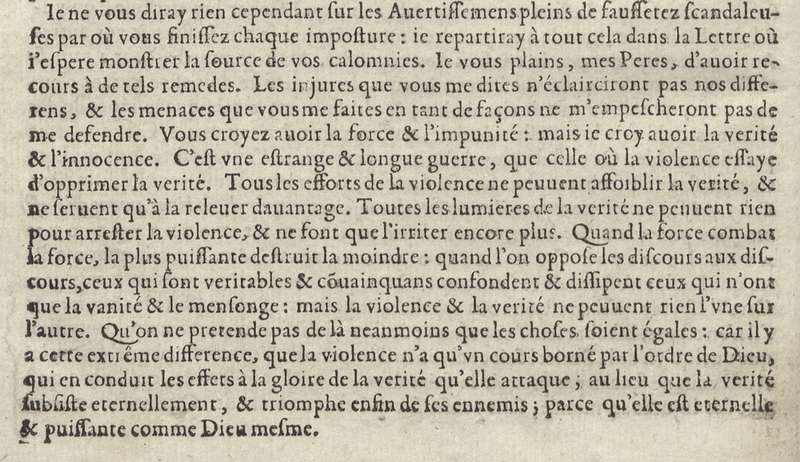
Les Provinciales paraissent d'abord sous forme de brochures imprimées clandestinement. Lorsqu’elles sont épuisées, le groupe de Port-Royal les fait réimprimer en volumes collectifs qui rencontrent toujours le même succès. Pour leur donner une audience internationale, Pierre Nicole, ami proche de Pascal et d’Antoine Arnauld, les traduit en latin, en y ajoutant des notes indispensables pour la compréhension des problèmes théologiques qui y sont traités. Il faut même traduire ces notes du latin au français, pour les mettre à portée du public.
La Bibliothèque du Patrimoine de Clermont conserve au moins une impression de chacune des 18 lettres à un provincial, certaines d'entres elles sont conservées en recueil relié d'époque, les autres en feuilles. Ces documents sont aujourd’hui mis en ligne sur le site Overnia, ainsi que de nombreux autres pièces de l’œuvre de Pascal et du groupe de Port-Royal.


